C’est un répertoire où l’offre est riche (voire pléthorique) et la concurrence rude : James Bowman, Gérard Lesne, Andreas Scholl, Jochen Kowalski, Carlos Mena, Philippe Jaroussky, Derek Lee Ragin, Jakub Józef Orliński, des voix et des sensibilités toutes différentes. Sans oublier bien sûr les Sara Mingardo ou Nathalie Stutzmann.
Tim Mead vient s’y inscrire avec un album judicieusement conçu, moitié sacré, moitié profane, exigeant des qualités presque antagonistes : un talent pour le chant élégiaque, introverti, suspendu, celui qui résonnait sous les voûtes des églises vénitiennes ou sous les plafonds de bois des scuole, et, à l’opposé, une fièvre, une vaillance, un mordant indispensables au stile concitato, celui des airs de fureur ou de vengeance dont l’opéra vénitien faisait grande consommation. S’y ajoute l’énergie, la virtuosité, l’électricité de l’Ensemble Arcangelo, sous la direction à la fois fougueuse et incisive de Jonathan Cohen.

© Mike Stone
Des débuts tardifs dans l’écriture vocale
Les deux pièces sacrées sont le célèbre Nisi Dominus et le moins connu Salve Regina en sol mineur RV 618, moins souvent enregistré que celui en ut mineur RV 616.
Le Nisi Dominus RV 608 fut composé sans doute vers 1713, alors que Vivaldi avait commencé depuis peu à écrire de la musique vocale sacrée. Largement trentenaire, il était alors professeur de violon à l’Ospedale della Pietà et c’est semble-t-il en tant que remplaçant du chef de chœur titulaire qu’il l’écrivit. C’est le moment aussi où il donne son premier opéra, Ottone in villa, représenté à Vicenza.
Ce Nisi Dominus commence spectaculairement par un Allegro brillant, où l’écriture vocale est d’une virtuosité quasiment violonistique, avec une vocalise monumentale sur « laboraverunt » : le verset professe que le labeur des maçons est inutile « si le Seigneur ne bâtit la maison » et Tim Mead peut d’emblée y montrer l’agilité de sa voix dans le registre fiorito (sans rien de laborieux, bien au contraire).
Le troisième verset « Surgite », lui aussi très figuraliste, semble vouloir illustrer ce qu’on disait plus haut, en faisant alterner l’exaltation des « Levez-vous » en lignes ascendantes très musclées et l’accablement des « qui manducatis panem doloris ». Tim Mead maîtrise à l’évidence les deux registres.
Dans l’élégie comme dans la fureur
Cependant l’essentiel de ce psaume fait appel au canto spianato, que ce soient le « Vanum est vobis », le « Beatus vir », ou surtout le « Gloria patri », en ré mineur, étonnamment sombre, où la voix dialogue avec une viole d’amour, sur de longues harmonies déroulées par l’orgue.
L’autre moment d’élection de ce psaume est l’illustre « Cum dederit », qui est un air de sommeil, sur le ronflement (ça va de soi) lancinant des cordes graves. Moment où Tim Mead peut faire appel au plus haut de son falsetto, et mettre en valeur l’homogénéité de sa voix.
On admire la façon dont il passe du chant non vibré, absolument horizontal, à un vibrato subtil, et sa manière de monter à des notes suspendues sur « fructus ventris », non seulement impeccables et délicates jusqu’au pianissimo final, mais traduisant le sens profond de ce verset : quand les hommes et les femmes auront glissé vers un sommeil éternel, les enfants, le fruit des entailles, seront l’héritage du Seigneur.

© Mike Stone
Du grave dans le falsetto
Le Salve Regina est une œuvre de maturité, de dix ans plus tardive, sans doute de la fin des années 1720, qui ne semble pas avoir été composée pour la Pietà. Il fut déniché à la fin des années 1920, dans des volumes de manuscrits conservés à Turin et qui sans doute avaient appartenu à Vivaldi. Cette collection contenait l’essentiel de ses opéras et de ses œuvres sacrées et ce fut le début de la redécouverte d’un compositeur dont on avait oublié l’essentiel pendant deux siècles.
D’une écriture plus élaborée que le Nisi Dominus, il fait appel à deux ensembles instrumentaux se répondant l’un l’autre, le premier s’enrichissant de la présence de deux hautbois.
Le prélude orchestral est d’une austérité saisissante, non seulement par son écriture fuguée, mais par les timbres blafards et les lignes obstinément descendantes que Vivaldi prête aux cordes. Il y a du désespoir dans cette supplication à la Vierge, à laquelle Tim Mead prête les couleurs très riches de son falsetto, notamment un registre grave charnu et solide. Une voix étonnamment longue dans le registre de tête, qui semble aller du contralto au soprano et accentue le dramatisme de cette séquence.
Voltige vocale
Le « Ad te clamamus » en ré mineur n’est pas moins impressionnant. Sur le paysage agitato des cordes, les sauts de notes très expressionnistes obligent la voix de Tim Mead à voltiger sans cesse du plus grave de sa tessiture au plus haut. A quoi s’ajoutent des vocalises, des ornements en escalier non moins spectaculaires. Cette intrication d’un brio quasi opératique et d’une expressivité tragique s’enrichit de chromatismes incessants dans le « Ad te suspiramus » en fa majeur (et les soupirs du texte ont leur illustration dans ceux de la ligne musicale).
C’est dans le « Eia ergo advocata » qu’interviennent les deux hautbois en contrepoint savoureux de la ligne vocale, témoignant à nouveau de l’attention aux textures de Vivaldi, qui traite ici la voix comme un instrument concertant. Tim Mead semble modifier son émission pour se plier à ces caprices d’écriture. La voix se fera tendre pour « Et Jesum benedictum », manière de berceuse, avant, dans la prière finale « O Clemens, O pia », de paraître se calquer sur les tirés et poussés des archets, et se promener avec naturel de notes graves vibrantes de sensualité jusqu’à des notes hautes d’une aisance limpide. Dernières notes apaisées, sincères, intimes.

© Mike Stone
Opéras-minute
On suppose que les deux cantates profanes, qui sont comme de brèves scènes d’opéra ont pu être écrites pour Anna Girò, la chanteuse préférée de Vivaldi, et il est vrai que Cecilia Bartoli a donné de Cessate, omai cessate une version saisissante dans la fureur comme dans la douleur. Mais les contre-ténors s’en sont emparé avec délices, les Jaroussky comme les Scholl ou les Cenčić, d’autant qu’il s’agit des affres d’un malheureux en butte aux avanies d’une ingrata Dorilla. Le pauvre inconsolable, en deux plaintes andante sur d’obsédants pizzicati des violons (une manière de signature vivaldienne), ou en stile recitativo, forme le dessein d’aller se réfugier dans des cavernes chéries (spelonche amate) avant d’aller rougir l’Achéron de son sang innocent.
Transports et désespoir
Cette scena alterne les récitatifs excessifs autant qu’expressifs (peut-être au second degré ?) et les lamenti les plus désespérés. Bartoli est comme chez elle dans ces transports grandiloquents, mais Tim Mead non moins.
La première aria, « Ah ch’infelice sempre », lui permet de faire alterner une voix blanche sur les parties plaintives et de vigoureux accents quand le malheureux se rebiffe. A nouveau on admire la longueur de la voix de Tim Mead et des vocalises d’une homogénéité parfaite sur toute la tessiture. On remarque sur « consolare » avec quelle maîtrise il passe au vibrato juste au moment où le non-vibré deviendrait agaçant pour l’oreille.
Dans l’aria « Nell’orrido albergo » qui conclut la cantate sur un tempo tempétueux, Tim Mead peut se livrer à une démonstration de virtuosité, multipliant les sauts de notes, les colorature acrobatiques, en parfaite fusion avec l’ensemble Arcangelo, électrique et précis.
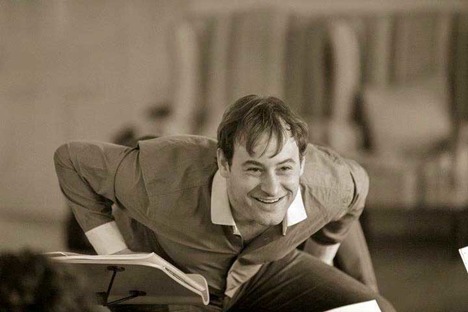
Jonathan Cohen © Mike Stone
L’autre cantate, « Amor, hai vinto » RV 683, est dans la même esthétique opératique, à ceci près que la première aria y est écrite dans un style fugué, alternant les notes piquées en canto di sbalzo et des colorature sillonnant tout l’ambitus (et les phrases tirées des archets semblent à l’unisson des affres du malheureux, qui va de tourment en tourment comme un navire pris dans une tempête).
L’ultime aria, de pure virtuosité, témoigne de la vaillance inépuisable de Tim Mead, mais aussi de son attention à varier les couleurs.
Langueurs lagunaires
Une attention que partagent Jonathan Cohen et Arcangelo et dont témoignent deux brèves séquences purement instrumentales. Le Concerto pour cordes en ré mineur RV 128 est du pur Vivaldi, sans surprise, mais tout en rebonds, en timbres acidulés, en nervosité, avec cette manière de scander le temps qui n’est qu’à lui (le largo) et ces fusées gorgées d’énergie, qui sont un défi pour les orchestres, défi brillamment relevé ici.
Mais les teintes, blêmes comme une brume sur le bassin de San Marco, de l’adagio molto initial de la Sinfonia « Al Santo Sepolcro » en si mineur RV 169 sont d’une beauté poignante, et Jonathan Cohen semble y arrêter le temps, étirer de longs silences, faire respirer douloureusement cette musique si personnelle, avant qu’un allegro impatient ne vienne balayer ces langueurs lagunaires.

© Andrew Staples









